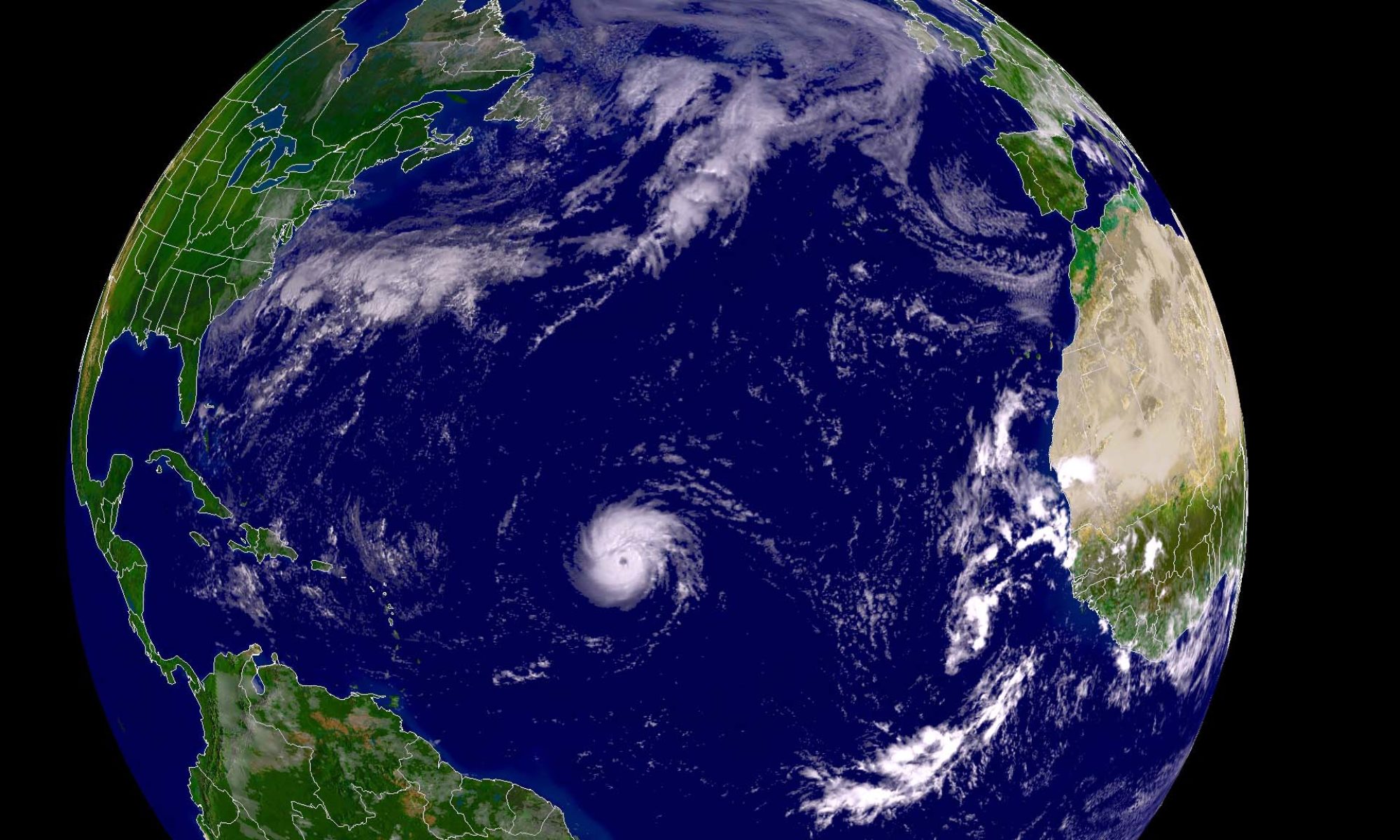27 mars 2014
Akio Matsumura
« Pourquoi n’avons-nous pas d’analyses d’urine ? Pourquoi n’avons-nous pas d’analyses de sang ? Deux précautions valent mieux qu’une. »
Anand Grover, le Rapporteur spécial des Nations Unies qui s’est rendu à Fukushima en 2012, a rappelé à Tokyo ce mois-ci qu’une recherche adaptée sur Fukushima et son impact sur la santé continue à faire défaut.
Peu de temps après l’accident de Fukushima il y a trois ans, des médecins ont cherché dans toute la préfecture de Fukushima des kystes, des nodules et autres tumeurs qui n’y seraient pas habituellement et pourraient indiquer un cancer de la thyroïde, l’un des effets possibles des radiations. Le nombre de tumeurs découvertes par les médecins est alarmant mais aussi surprenant : normalement les cancers de la thyroïde ne devraient apparaître que cinq ans après l’exposition aux radiations.
Mais alors, que doivent faire les médecins et les responsables sanitaires japonais de cette information ?
Information et précaution, apparemment, ne sont pas les bienvenues au Japon. Le pays a l’intention de redémarrer ses réacteurs nucléaires et de laisser les réfugiés de Fukushima revenir dans les zones qui ont été évacuées. Toute étude indiquant que l’exposition aux radiations peut avoir des effets délétères ne peut qu’entraver ce mouvement vers le progrès économique.
Le Japon a donc pris des mesures subtiles pour freiner les preuves qui pourraient laisser penser que ces décisions n’ont pas vraiment à cœur les intérêts de ses citoyens. Le Japon peut entraver les études scientifiques permettant d’obtenir de nouvelles informations et de nouvelles preuves de deux façons : en mettant fin aux financements et en imposant une culture du secret faisant en sorte que les chercheurs hésitent à parler à la presse.… Continue reading